La diversité face à la montée des nationalismes dans la littérature jeunesse (1/3)
La littérature jeunesse n’est jamais neutre. Bien plus qu’un simple outil de divertissement, elle participe à la construction des normes culturelles, sociales et politiques dès le plus jeune âge. Elle véhicule des imaginaires puissants : ceux de l’enfance idéale, de la famille-type, du monde tel qu’il « devrait » être – ou, à l’inverse, tel qu’il ne faudrait pas qu’il devienne. Les personnages, les intrigues et les représentations qui peuplent les albums illustrés dessinent, livre après livre, les contours symboliques de notre société.
Or, ces représentations ne sont pas figées. Elles évoluent au rythme des tensions sociétales, des luttes idéologiques et des mouvements politiques. Dans les périodes de repli identitaire ou de montée des nationalismes, la littérature jeunesse devient souvent un terrain de bataille implicite : ce qui est publié, promu ou censuré révèle les lignes de fracture d’un monde adulte en quête de contrôle sur l’imaginaire des enfants.
Depuis quelques années, plusieurs études soulignent à la fois un élan vers plus d’inclusivité (diversité ethnique, genres, familles, corps, handicaps…) et une réaction inverse, où ces efforts sont perçus comme une menace idéologique. Aux États-Unis, ce phénomène a pris une ampleur inédite, marquée par la censure active de milliers de livres jeunesse. Ces tensions ne s’arrêtent pas aux frontières américaines. En Europe, la dynamique semble moins frontale mais tout aussi significative : retrait discret d’albums des sélections scolaires, controverses éditoriales, essor d’un discours conservateur dans la presse éducative.
En Belgique francophone, un climat plus discret mais tout aussi révélateur se dessine : recul de certains soutiens à la diversité, remise en cause des initiatives inclusives dans les écoles, éditoriaux conservateurs dans la presse éducative. Les livres jeunesse deviennent alors le théâtre de luttes idéologiques bien réelles, où ce qui est publié – ou non – dessine les contours de notre société de demain.
Dès lors, comment les représentations proposées aux enfants évoluent-elles à l’ombre des tensions politiques ? Et plus spécifiquement, quels sont les liens entre la montée des idéologies nationalistes et les représentations dans la littérature jeunesse contemporaine ?
Dans ce premier volet, je poserais les bases de cette réflexion : pourquoi représenter le monde dans toute sa diversité dès l’enfance est-il essentiel ? Quels sont les chiffres qui illustrent les déséquilibres encore présents dans la production éditoriale jeunesse ? Et comment la montée des nationalismes entre en collision avec ces ambitions ?
L’objectif est double : ancrer la question de la diversité dans une réalité chiffrée et documentée, puis analyser comment ce mouvement de fond suscite des résistances croissantes, parfois organisées, parfois spontanées – mais toujours révélatrices des peurs sociales qui traversent nos sociétés.
I. Représenter ou invisibiliser ?
La littérature jeunesse comme fabrique des normes
La littérature jeunesse ne se résume jamais à un simple divertissement. Dès les années 1970, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron insistaient sur le rôle socialisateur des institutions culturelles comme l’école, qui transmettent des normes implicites et des hiérarchies symboliques à travers leurs contenus. Dans La Reproduction (1970)[i], ils démontrent que les objets culturels – manuels, récits, supports éducatifs – participent à la perpétuation des structures sociales. Les livres pour enfants, bien qu’extérieurs au cadre scolaire formel, sont tout autant porteurs de ces transmissions.
Le chercheur Gilles Brougère, spécialiste de l’éducation par le jeu, rappelle que les albums jeunesse ne sont pas neutres. Ils véhiculent des visions du monde, structurent les imaginaires des enfants, et contribuent à façonner leurs représentations du réel : ce qui est « normal », ce qui est « désirable », ce qui est possible – ou pas. (Jouet et compagnie, 2003[i])
Umberto Eco, dans Lector in fabula (1979)[ii], va plus loin encore : le livre, dit-il, est une « machine paresseuse ». Il ne fonctionne que si le lecteur l’active par son imaginaire, mais cet imaginaire est déjà balisé par des codes partagés. Ainsi, l’enfant ne lit jamais dans le vide : il interprète à travers les structures culturelles que lui propose le texte.
[i] Brougère, G. (2003). Jouets et compagnie. Stock.
[ii] Eco, U. (1979). Lector in fabula: La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. Bompiani.
[i] Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La reproduction: Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Les Éditions de Minuit.

Books are sometimes windows, offering views of worlds that may be real or imagined, familiar or strange. These windows are also sliding glass doors, and readers have only to walk through in imagination to become part of whatever world has been created or re-created by the author. When lighting conditions are just right, however, a window can also be a mirror. Literature transforms human experience and reflects it back to us, and in that reflection, we can see our own lives and experiences as part of the larger human experience.
En 1990, l’autrice américaine Rudine Sims Bishop[i] théorise cette idée à travers une métaphore devenue centrale dans les études sur la diversité littéraire. Les livres, écrit-elle, sont à la fois des miroirs dans lesquels les enfants se reconnaissent, des fenêtres sur d’autres vécus, et parfois des portes coulissantes qui leur permettent d’entrer symboliquement dans des réalités différentes
[i] Bishop, R. S. (1990). Mirrors, windows, and sliding glass doors. Perspectives: Choosing and Using Books for the Classroom, 6(3), ix–xi.
Cette fonction réflexive est d’autant plus cruciale à l’enfance, au moment où les identités sont en cours de formation. Les enfants ont besoin de se voir dans les récits qu’ils consomment – mais aussi de rencontrer d’autres façons d’être, d’aimer, de vivre ou de résister.
C’est ici que la philosophe Judith Butler apporte un éclairage essentiel. Dans Gender Trouble (1990)[i] et ses travaux ultérieurs, elle développe la notion de performativité des normes : les identités de genre, mais aussi les rôles sociaux plus larges, ne sont pas innés. Ils sont produits par la répétition de gestes, de discours, de représentations. Les récits jouent donc un rôle fondamental dans la constitution même des identités :
“There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very ‘expressions’ that are said to be its results.” (Butler, 1990)
En d’autres termes, ce que les enfants lisent – ou ne lisent pas – participe à la construction de leurs identités sociales et culturelles. Invisibiliser certaines figures (familles non-normatives, personnes racisées, enfants en situation de handicap…) revient à nier la possibilité même de leur existence dans le champ du pensable.
C’est pourquoi l’enjeu de la représentation dans la littérature jeunesse ne relève pas d’une lubie idéologique. Il s’agit, fondamentalement, de savoir qui a le droit d’exister dans les récits que l’on propose aux enfants, et qui reste relégué à la marge, au silence, ou à la caricature.
[i] Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.
II. Qui décide de ce que lisent les enfants ? Maisons d’édition, politiques publiques et médiateurs culturels
Si les livres jeunesse sont des vecteurs puissants de socialisation et de représentation, il importe d’interroger les rouages invisibles qui déterminent ce qui est publié, promu ou mis à disposition des jeunes lecteurs. Les récits proposés aux enfants ne sont jamais neutres : ils résultent d’un faisceau complexe de choix éditoriaux, de politiques publiques et d’arbitrages faits par les médiateurs culturels. Loin d’être spontanée ou purement artistique, la production jeunesse est traversée par des enjeux économiques, idéologiques et sociaux qui influencent la diversité – ou la normalisation – des imaginaires proposés.
Le poids des maisons d’édition et des logiques de marché
Les maisons d’édition jouent un rôle central dans la définition des représentations disponibles. Leur ligne éditoriale, combinée à des impératifs de rentabilité, conditionne fortement la diversité des récits publiés. Comme le souligne Brougère (2003), les albums pour enfants ne se contentent pas d’émerger d’une intention pédagogique ou artistique : ils répondent aussi aux attentes supposées du marché et aux projections sociales des adultes sur l’enfance.
Dans ce contexte, les « figures de l’enfance » dominantes (enfant blanc, cisgenre, valide, appartenant à une famille nucléaire de classe moyenne) tendent à se reproduire dans la majorité des ouvrages. Les éditeurs cherchent souvent à éviter les « sujets sensibles » – notamment autour du genre, de la race ou des sexualités – par crainte d’une réception controversée ou d’une perte de lectorat. La concentration croissante du secteur éditorial, notamment en France, renforce cette tendance : les grandes maisons généralistes disposent d’un quasi-monopole sur la visibilité, et privilégient les titres consensuels, faciles à vendre, au détriment d’ouvrages plus audacieux.
Certaines maisons indépendantes ou militantes s’efforcent néanmoins de proposer une offre alternative, centrée sur des récits plus diversifiés, portés par des auteur·rice·s issu·e·s de groupes minorisés[i]. Mais leur accès à la diffusion et à la prescription demeure limité. L’inégale répartition des moyens marketing renforce ainsi l’hégémonie des récits normatifs.[ii]
[i] Les Ourses à plumes. (2016, 22 décembre). Talents Hauts: une maison d’édition engagée [Entretien avec Laurence Faron & Mélanie Decourt]. Les Ourses à plumes. (en ligne) Disponible sur : https://lesoursesaplumes.info/2016/12/22/talents-hauts-une-maison-dedition-engagee/
[ii] ActuaLitté. (2024, mars 15). Librairies, diffusion : le défi des éditeurs indépendants. ActuaLitté.
Le rôle ambivalent des politiques publiques
Les politiques publiques peuvent jouer un rôle de levier ou de frein dans la diversité éditoriale. En Belgique francophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles finance ponctuellement des projets « citoyens » ou « multiculturels » via des appels à projets ou des subsides à l’édition jeunesse[i]. En France, le Centre national du livre (CNL) ou certaines collectivités locales soutiennent des initiatives favorisant l’inclusion.[ii]
[i] Appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif aux droits de l’enfant ou Un Futur pour la Culture
[ii] Centre national du livre. (2025). Aides. CNL.
Cependant, ces politiques restent fragiles et parfois ambivalentes. Les soutiens financiers ponctuels ne compensent pas toujours les pressions structurelles du marché. De plus, la notion même de « diversité » peut être instrumentalisée à des fins politiques – tantôt promue comme valeur civique, tantôt soupçonnée de véhiculer une idéologie jugée « militante ». Les débats récents sur les critères d’attribution des aides ou sur la légitimité de certaines thématiques (identités de genre, parentalités LGBTQIA+, représentations racisées) montrent que l’intervention publique dans le champ culturel est elle-même traversée par des tensions idéologiques.[i]
[i] Le Monde. (2024, juin 16). « La culture n’a plus aucun poids dans le débat politique ».
Libraires, bibliothécaires, prescripteurs : des passeurs sous contrainte
Les professionnel·le·s de la médiation – bibliothécaires, libraires, enseignant·e·s, animateur·rice·s – constituent les maillons visibles de cette chaîne de transmission. Leur rôle est déterminant : ce sont eux qui sélectionnent, mettent en avant ou commentent les ouvrages auprès des familles et des enfants.
Mais là encore, leur marge de manœuvre est souvent réduite. Les ouvrages les plus visibles, ceux qui bénéficient des meilleures ventes ou des campagnes promotionnelles massives, proviennent en majorité des grandes maisons. Les ouvrages porteurs de représentations minoritaires, moins diffusés, demandent un travail de repérage et de médiation supplémentaire. Or, dans des contextes de surcharge ou de contraintes budgétaires, il n’est pas toujours possible de garantir ce travail de diversification.
Une production encore déséquilibrée
Aux États-Unis, selon le Cooperative Children’s Book Center (CCBC), 51 % des livres reçus en 2024 mettaient en scène un ou plusieurs personnages BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) soit une augmentation de 2% par rapport à l’année précédente (CCBC, 2025)[i]. En revanche, le nombre de livres mettant en vedette un personnage principal ou un sujet humain issu des minorités ethniques, raciales et raciales (BIPOC) a diminué de 3%. Parmi les livres reçus en 2024, 7 % présentaient un personnage principal ou secondaire important en situation de handicap et 7 % abordaient des thèmes ou des personnages LGBTQ+, soit des chiffres inchangés par rapport à 2023.
[i] Cooperative Children’s Book Center. (2025, March 13). CCBC’s Diversity Statistics show promising growth in diverse children’s books in 2024, but room for progress [Press release]. School of Education, University of Wisconsin–Madison. https://ccbc.education.wisc.edu
En France, une étude récente menée par Sarah Ghelam (Université de Cergy) souligne que les albums publiés entre 2010 et 2023 restent largement centrés sur des enfants blancs, dans des configurations familiales dites traditionnelles. Les personnages racisés, handicapés ou issus de familles LGBTQIA+ sont rares, souvent cantonnés à des récits secondaires ou à des traitements stigmatisants centrés sur la différence ou le trauma.
En Belgique francophone, aucun baromètre officiel n’existe à ce jour. Toutefois, la forte diffusion d’albums issus de l’édition française rend ces données partiellement transférables au contexte belge.
Ces constats posent une question fondamentale : qui décide de ce que les enfants peuvent lire, voir, imaginer ? Et comment garantir que cette offre reflète véritablement la pluralité du monde contemporain, au-delà des normes implicites du marché éditorial ?
III. Imaginaire dominant vs diversité des expériences : quelle place pour les récits en marge ?
Dans le prolongement des logiques éditoriales et institutionnelles évoquées précédemment, il importe d’interroger un autre mécanisme plus insidieux : celui de la reconduction silencieuse des normes par l’imaginaire dominant. La littérature jeunesse, loin d’être un simple reflet du réel, participe à la fabrication du monde tel qu’il est perçu et intériorisé par les enfants. À travers les choix de personnages, de familles, de situations ou de cadres culturels, elle dessine les contours implicites de ce qui est jugé « normal », désirable ou possible.
L’idéologie invisible des récits dominants
La littérature jeunesse est traversée par des tensions entre la norme et la marge, entre les récits dominants (famille nucléaire, personnages blancs, valides, cisgenres) et les tentatives de rendre visibles d’autres parcours de vie. En l’absence de diversité intentionnelle, l’imaginaire dominant se reconduit de manière invisible, en diffusant des standards implicites du monde social : qui est un héros ? qui a droit à l’aventure ? qui reste dans l’arrière-plan ? Or, comme le rappellent les travaux sur la socialisation implicite (Bourdieu, Passeron, 1970 ; Brougère, 2003), ce n’est pas seulement ce qui est dit qui importe, mais ce qui est laissé pour acquis, ce qui ne se nomme pas.
L’uniformité des représentations agit comme une naturalisation du monde social. Un héros qui court dans les bois pour sauver le royaume n’a pas à justifier sa place ; une héroïne racisée ou en fauteuil roulant, en revanche, est souvent contrainte de « thématiser » sa différence. C’est là que la diversité des représentations ne doit pas être vue comme un ajout militant ou « politique » — elle l’est toujours, mais tout autant que l’uniformité. Ainsi, l’absence de diversité n’est pas neutre. L’idéologie implicite des albums traditionnels (le prince sauve la princesse, la famille blanche hétéroparentale est la norme, le handicap est rare et problématisé) est rarement remise en question, car elle s’est naturalisée. Elle construit un imaginaire restreint, où seuls certains enfants peuvent s’identifier spontanément, tandis que les autres apprennent, implicitement, qu’ils n’ont pas leur place au centre du récit (Bishop).
Diversité des représentations : un enjeu universel
Trop souvent perçue comme une revendication minoritaire ou militante[i], la demande de diversité dans les livres pour enfants concerne en réalité l’ensemble du jeune lectorat. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement la reconnaissance symbolique des enfants minorisés, mais bien la formation de l’ensemble des imaginaires sociaux.
[i] De Pape, N. (2021, 26 novembre). Le wokisme prospérera tant qu’il n’aura pas d’opposition structurée contre lui [Entretien]. Le Figaro Vox. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/le-wokisme-prosperera-tant-qu-il-n-aura-pas-d-opposition-structuree-contre-lui-20211126
Valentin, P. (2021, 10 septembre). Le mouvement “woke” pratique l’autodafé au nom de l’inclusivité [Tribune]. Le Figaro Vox. https://www.lefigaro.fr/vox/societe/le-mouvement-woke-pratique-l-autodafe-au-nom-de-l-inclusivite-20210910
Les enfants construisent leur vision du monde à partir des modèles qui leur sont proposés. Lorsqu’ils ne voient que des familles blanches, des filles douces et des garçons courageux, ils en déduisent que c’est là la norme. Cette représentation biaisée du réel peut renforcer, dès le plus jeune âge, des stéréotypes sociaux, raciaux et de genre.
Pour une pluralité de modèles
L’absence de diversité n’impacte pas seulement les enfants minorisés. Elle renforce les biais et les stéréotypes de tous les enfants, en leur offrant une vision homogène du monde, souvent blanche, cisgenre, valide, de classe moyenne. À l’inverse, une littérature plurielle contribue à beaucoup de choses.
- Elle renforce l’empathie, en exposant les enfants à des vies différentes des leurs.
- Elle valorise les enfants minorisés, en leur offrant des héros qui leur ressemblent.
- Elle lutte contre les stéréotypes, en rendant visibles des alternatives positives.
- Elle favorise la curiosité, en suscitant l’envie de découvrir d’autres récits.
Plusieurs études en psychologie de l’enfance confirment que les biais raciaux, de genre ou d’orientation sexuelle peuvent apparaître dès 3 à 5 ans, et que la répétition d’images stéréotypées renforce ces biais si aucune alternative n’est proposée (Bigler & Liben, 2007).
[i] National Education Association. (2019, juillet–août). Why we need diverse books. NEA Today. Consulté sur https://www.nea.org/nea-today/all-news-articles/why-we-need-diverse-books ; Song, C. (2023). The importance of representation in books. Verywell Mind.
[i] Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2007). Developmental intergroup theory: Explaining and reducing children’s social stereotyping and prejudice. Current Directions in Psychological Science, 16(3), 162–166. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00496.x
Conclusion de ce volet
La littérature jeunesse, loin d’être un simple objet de divertissement, constitue un espace de projection idéologique et un outil de transmission culturelle. Comme nous l’avons vu dans ce premier volet, elle participe à la fabrique des normes sociales dès le plus jeune âge – qu’il s’agisse de genre, d’origine, de famille ou de corps. Or, en l’absence de vigilance éditoriale, c’est l’imaginaire dominant qui s’impose : blanc, hétéro, cisgenre, valide, de classe moyenne.
Malgré la multiplication d’initiatives inclusives, les chiffres montrent que la diversité des représentations reste minoritaire dans les albums jeunesse, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Belgique. Ce déséquilibre ne relève pas du hasard : il résulte de choix éditoriaux, d’impératifs commerciaux, de politiques publiques parfois timides, et de rapports de force culturels bien réels.
Dans ce paysage déjà tendu, les crispations identitaires prennent une place croissante. Aux États-Unis, mais aussi en Europe, des mouvements nationalistes ou conservateurs s’emploient à retirer des rayons certains livres, à dénoncer des auteurs, à accuser les récits inclusifs de propagande. Ce retour offensif de la censure, qu’elle soit légale, sociale ou symbolique, montre combien les livres pour enfants sont devenus un terrain d’affrontement culturel.
Ce sera l’objet de notre deuxième volet, consacré aux formes contemporaines de censure, backlash et replis identitaires, à commencer par le cas américain.
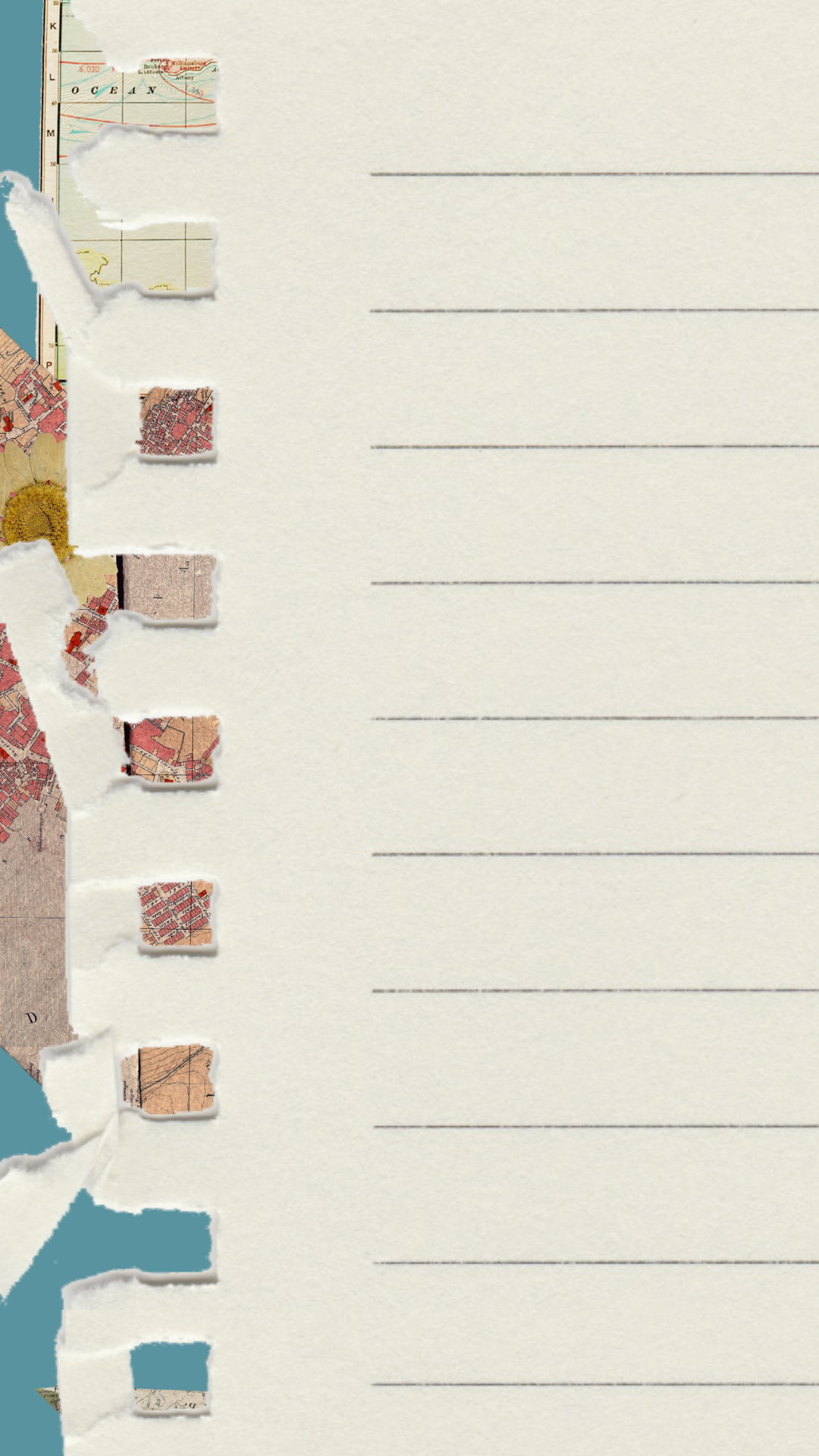
Découvre également
Édito du mois d’août
Août, c’est ce moment suspendu entre les jeux d’eau, les valises ouvertes et les cahiers à préparer. Un mois de bascule, où la légèreté des vacances rencontre déjà le poids symbolique de la rentrée. Et si c’était justement le bon moment pour repenser nos récits de...
Une rentrée pas comme les autres : 4 albums pour accueillir les émotions et les différences
La rentrée ne se vit pas de la même manière pour tous les enfants. Pour certains, c’est une fête ; pour d’autres, un saut dans l’inconnu chargé de doutes, d’angoisses, ou de solitude.Et puis il y a ceux dont le rythme, le fonctionnement ou la sensibilité ne cadrent...
6 albums pour une rentrée inclusive : accueillir chaque élève tel qu’il est
La rentrée est un moment fondateur.C’est là que se tissent les premières impressions, les premiers liens, les premiers repères. Un moment de transition fragile… mais aussi une occasion précieuse de semer, dès le départ, les graines de l’inclusion. Et si, cette année,...
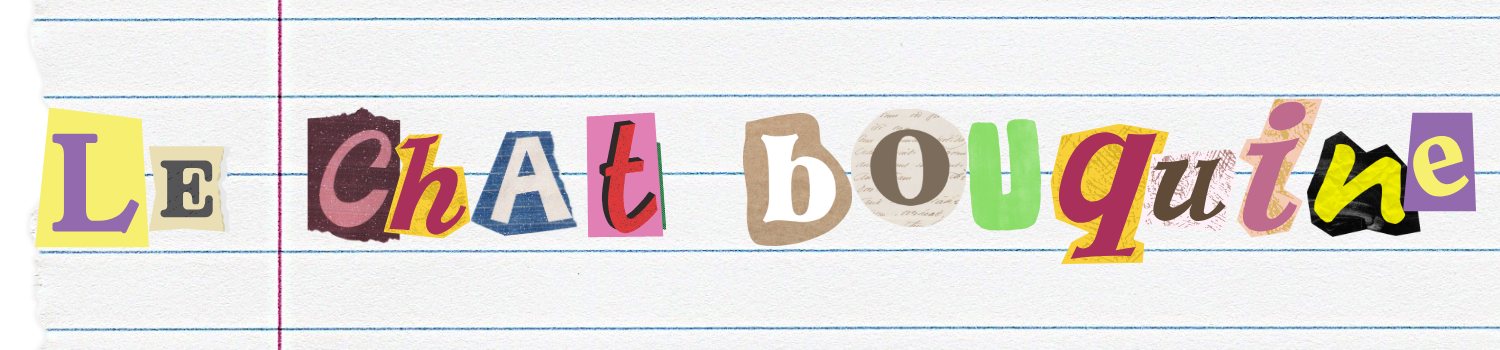
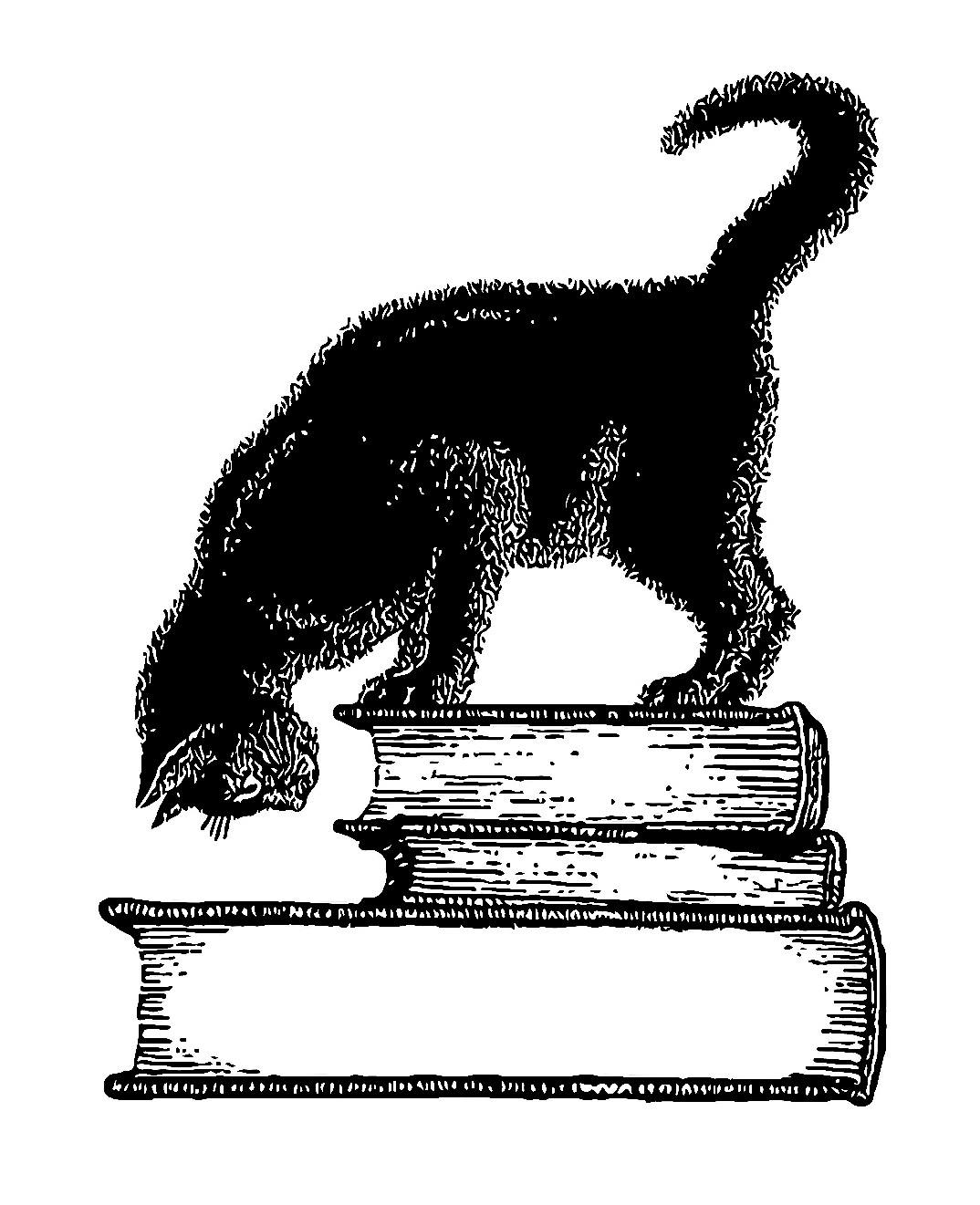
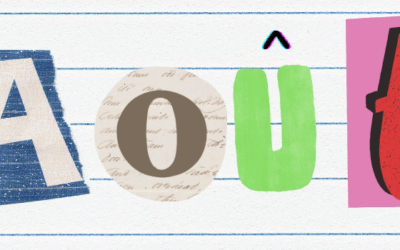


0 commentaires